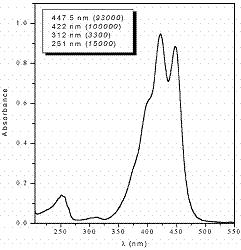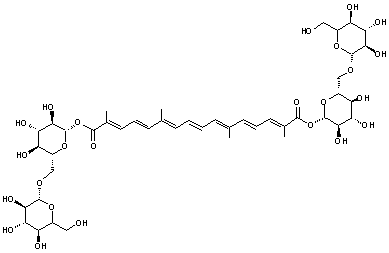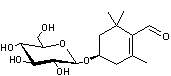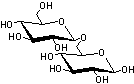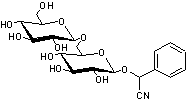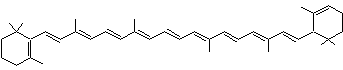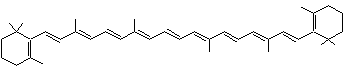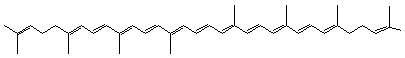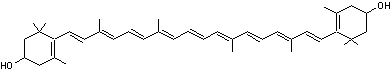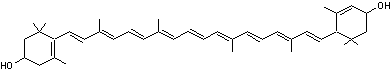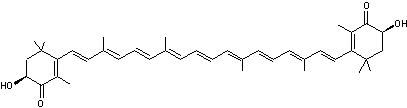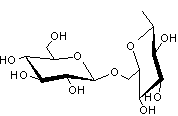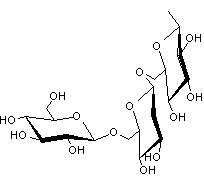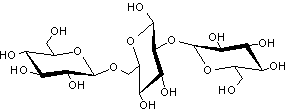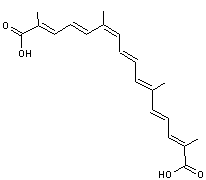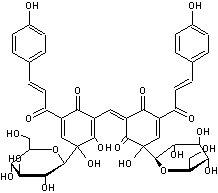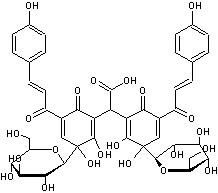LE
SAFRAN
Gérard Gomez
avec la collaboration de
Jacques Baron
Plan de l'étude
1) Généralités
2-1) Composition
générale
2-2) Composés
biologiquement actifs
2-2-1) Crocétine et Crocine
2-2-2) Le safranal
2-2-3) La picrocrocine
2-3) Synthèse
des quatre métabolites du safran à activité spécifique
Annexe 1 Crocus sativus,
étamines, pistil, stigmates.
Annexe 2 gentiobiose
Annexe 3 Caroténoïdes
Annexe 4 La couleur du safran
Annexe 5 Les crocines
Annexe 6 Le safran pur
Annexe 7 Formules de la carthamine et de la
précarthamine
Le mot
"safran" a une origine latine. Il provient du mot latin
"safranum", qui à son tour est emprunté au mot arabe
"za'farān".
Le
safran est connu depuis plus de 3 500 ans. Originaire d'Asie centrale, il s'est
répandu à travers les civilisations, de la Grèce antique à l'Inde médiévale. Le
commerce florissant du safran a été un moteur de l'économie dans des régions
telles que la Perse et certaines régions bordées par la Méditerranée.
L'utilisation
du safran remonte à l'Antiquité, et il a joué un rôle important tant dans la
cuisine que dans la médecine traditionnelle. Son nom a été transmis à travers
différentes langues et cultures, illustrant le commerce et l'échange de
connaissances à travers les civilisations au fil du temps.
|
|
Dérivé
des stigmates séchés de la fleur de Crocus sativus (voir annexe 1), il est une épice précieuse ; en effet, son
histoire riche, ses utilisations diverses et ses propriétés en font l'une des
épices les plus recherchées au monde. La
culture du Crocus sativus demande des conditions spécifiques, avec un
sol bien drainé et un climat ensoleillé. Chaque fleur ne produit que quelques
brins de safran (une fleur donne trois stigmates, minces filaments rouges ;
il faut environ 150 à 200 fleurs de crocus pour produire 1g de safran),
nécessitant une récolte manuelle minutieuse à l'aube, lorsque les fleurs
s'ouvrent. Cette méthode contribue à la rareté et à la valeur du safran. |
Le
safran est considéré comme pur lorsqu'il est conforme aux exigences fixées dans
la norme ISO 3632 (2 parties : ISO 3632-1 : 2011 et ISO 3632-2 : 2010 voir annexe 6) et qu'aucune matière n'a été ajoutée au produit
naturel. Cette norme spécifie les méthodes d'essai pour les différentes formes
sous lesquelles se présente le safran séché – en filaments entiers, coupés et
en poudre.
"
Les analyses chimiques faites sur les stigmates de Crocus sativus"
ont révélé la présence de plus de cent-cinquante éléments, avec une composition
approximative de :
- 10% d'eau,
- 12% de protéines et d'acides
aminés,
- 5% de graisses,
- 5% de minéraux
(Mn,Mg,P,Cu,Ca,Zn,Fe, …)
- 5% de fibres brutes (fibres
solubles : certaines hémicelluloses ; fibres insolubles : cellulose,
hémicelluloses insolubles et lignines).
- 63% de sucres incluant l'amidon,
les sucres réduits, les pentosanes, les gommes, les pectines et les dextrines.
- Il s'y ajoute de petites quantités
de caroténoïdes et de flavonoïdes (voir annexe 3) ainsi
que des quantités infimes de vitamine B2 (riboflavine) et de vitamine B1
(Thiamine).
Cependant,
les proportions de ces constituants peuvent varier en raison des conditions de
croissance et du pays d'origine."
(Thèse
de Claire Palomares : Le safran, précieuse épice ou précieux médicament ?
https://hal.univ-lorraine.fr/hal-01732922/document)
2-2) Composés
biologiquement actifs
On distingue
quatre métabolites secondaires du safran à activité biologique ; Ils ont un
rôle sur l'aspect (la couleur par exemple), mais aussi sur la saveur, l'arôme
et encore sur les propriétés médicinales qu'on prête au safran ; ce sont la
crocétine, la crocine, le safranal et la picrocrocine.
Ce sont
ces molécules qui communiquent leur couleur au safran (voir annexe
4). Elles sont sensibles à l'air et à la lumière ce qui explique qu'il
faille conserver cette épice à l'abri de la lumière et de l'air si on veut
garder sa fraîcheur.
- Crocétine :
|
Crocétine ou Acide
8-8'-Diapo-Ψ,Ψ'-carotènedioïque
C20H24
O4 Aspect : Cristaux
orthorhombiques de couleur rouge brique. Masse
molaire : 328,403
g.mol-1 Fusion
: 286°C N°
CAS : 27876-94-4 Solubilité : Très
soluble dans la soude ; soluble dans la pyridine ; légèrement soluble dans
l'eau et l'éthanol ; insoluble dans l'éther et le benzène. |
C'est
un diacide carboxylique. Il
appartient à la famille des Caroténoïdes (voir annexe 3)
et est responsable de la couleur du safran. Sa
courbe d'absorption UV visible
montre
deux maxima principaux d'absorption à respectivement 422 nm et 447,5 nm. La
couleur de ce composé en poudre se situe dans le rouge brique. |
-
α-Crocine :
|
C44
H64O24 Aspect : Poudre
rouge orangé Masse
molaire
: 976,9646
g.mol-1 Fusion : 186 °C Solubilité : Soluble
dans l'eau ; cette solubilité est due à la présence des deux diholosides aux
extrémités. N°
CAS
: 42553-65-1
|
Hétéroside
ayant comme partie aglycone la crocétine et comme partie glucidique un
diholoside le gentiobiose (voir annexe
2). C'est
également un diester ; le diacide correspondant étant la crocétine. Il
appartient enfin à la famille des caroténoïdes. On le
trouve donc dans la fleur de safran (Crocus sativus L.). Elle
constitue 6 à 16% de la matière sèche des stigmates de la fleur. Elle
est utilisée par l'industrie alimentaire comme colorant naturel. La
crocine plus que la crocétine constitue un bon colorant alimentaire du fait
de son hydrosolubilité. Remarque : Il
existe en fait plusieurs crocines qui correspondent à des hétérosides ayant
la même partie aglycone mais des parties glucidiques différentes (voir annexe 5). |
C'est la
molécule qui communique son parfum au safran. L'huile essentielle de safran qui
contient le safranal est parfois extraite pour diverses utilisations, y compris
en parfumerie.
|
Safranal ou 2,6,6-triméthyl-1,3-cyclohexadiène-1-carboxaldéhyde.
C10H14O
Ebullition : 70°C
(sous 1 mm de Hg) Indice
de réfraction
: 1,5281
(à 19 °C) Solubilité : Très
soluble dans l'éthanol et l'éther de pétrole. N°
CAS 116-26-7 |
C'est
l'un des composés chimiques clés du safran. Il se
présente sous la forme d'une huile volatile. C'est
un antioxydant qui est actuellement étudié pour ses possibles effets
neuroprotecteurs. C'est
un monoterpène qui dérive de la dégradation de la picrocrocine à la suite du
processus de séchage où interviennent les effets conjugués de la chaleur et
des enzymes (voir la biosynthèse des composés du safran
en 2-3). C'est enfin
un aldéhyde aromatique qui constitue environ 82% des composants volatils de
l'huile essentielle extraite du safran. |
Remarque : D'autres composés
volatils participent à l'odeur de cette épice
; ils sont présents en quantité moindre que le safranal.
Ce sont
essentiellement :
- l'isophorone :

- la 4-oxoisophorone :

- la
2,2,6-triméthylcyclohexan-1,4-dione :

- la
2-hydroxy-4,4,6-triméthylcyclohexa-2,5-dièn-1-one :

- la
2,6,6-triméthylcyclohexa-1,4-diène-1-carboxaldéhyde :

C'est
la molécule qui est responsable de la légère amertume du safran qui participe à
son goût caractéristique.
Son nom
l'indique d'ailleurs, le préfixe picro- provient du grec ancien
"pikros" qui signifie amer ou âpre.
|
ou 4-(β-D-glucopyranosyloxy)-2,6,6-triméthyl-1-cyclohexène-1-carboxaldéhyde.
C16H26O7
fusion : 155°C N°
CAS 138-55-6 |
Hétéroside
ayant comme partie aglycone le safranal et comme partie glucidique, le
β-D-glucose. Comme la
crocétine, la crocine et le safranal, la picrocrocine est un produit de
dégradation de la zéaxanthine, un caroténoïde. |
Remarque :
Vu le
prix de vente du safran qui est très élevé, nombreuses sont les tentations de
falsification. L'une d'elles consiste à remplacer les stigmates de safran par
des fleurons de carthame renfermant deux pigments polyphénoliques : la
carthamine ( rouge et soluble dans l'eau en milieu basique), et la
précarthamine (jaune) (voir annexe 7)
2-3) Synthèse
des quatre métabolites du safran à activité spécifique
Parmi
les caroténoïdes du safran, on trouve de la zéaxanthine.
Sous
l'effet de diverses enzymes, la zéaxanthine présente dans le safran, se dégrade
en donnant de la crocétine, de la crocine, de la picrocrocine, et du safranal.
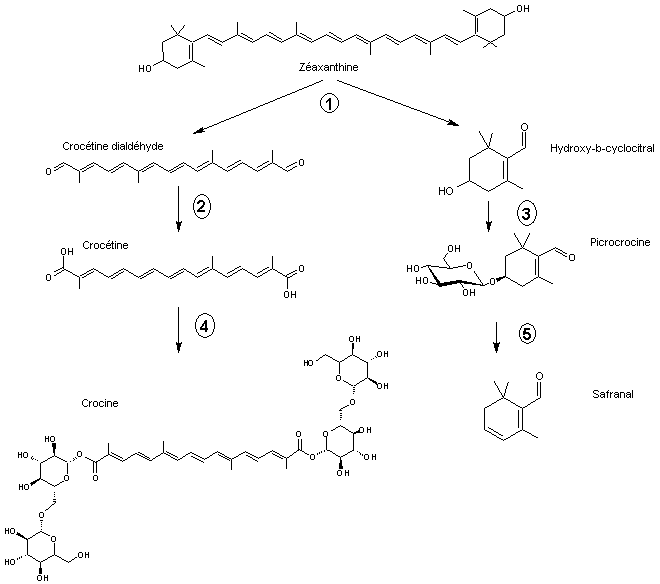
Les
enzymes qui interviennent dans ce schéma sont repérées par des numéros :
-1- La Crocus sativus
Zéaxanthine Cleavage Dioxygénase (CsZCD)
-2- L'aldéhyde
oxydoréductase
-3-
UdP-Glucosyltransférase
-4-
UdP-Glucosyltransférase
-5- C'est lors de
l'opération de séchage.
Annexe 1 Crocus
sativus, étamines, pistil, stigmates.
- Le Crocus sativus, communément appelé crocus à safran,
est une plante herbacée vivace appartenant à la famille des Iridacées.
- Le crocus à safran est caractérisé par des fleurs violettes à
six pétales (en fait 3 pétales et 3 sépales semblables), avec trois étamines et
un pistil.
Le style de ce pistil, surmontant l'ovaire (bulbe), se prolonge
par 3 stigmates séparés, rouges, filiformes, très allongés (longueur d'environ
3cm) légèrement évasés et crénelés à l'extrémité.
- Ses feuilles, étroites et allongées apparaissent après la floraison.
- La plante est relativement petite, atteignant généralement une hauteur de 10
à 30 centimètres.
Le Crocus sativus est cultivé principalement pour ses stigmates,
la partie femelle de la fleur.
- La récolte du safran est un processus minutieux, chaque fleur produisant
trois stigmates rouge vif.
- La récolte est souvent effectuée à la main, ce qui explique en partie le coût
élevé de cette épice ; 3 étapes : la récolte, l'émondage (séparation des
stigmates du reste de la fleur) et séchage
Bien que d'origine probable du Moyen-Orient, le Crocus sativus est
aujourd'hui cultivé dans diverses régions du monde, notamment en Iran, en Inde,
en Espagne, en Grèce et même en Hongrie.
|
|
|
Annexe 2 gentiobiose
|
Gentiobiose
ou ou 6-O-β-D-glucopyranosyl-D-glucose C12H22O11 Masse
molaire : 342,2965
g.mol-1 Fusion : 190 à
195°C Solubilité : Soluble
dans l'eau chaude et le méthanol chaud. |
Diholoside
n'existant pas à l'état libre. On le trouve à l'état naturel sous forme d'
hétérosides comme par exemple - la
crocine (voir plus haut) -
l'amygdaloside :
présent dans les amandes amères et les noyaux de certains fruits (les
drupes: cerises, abricots, prunes). Il a été mis en évidence en 1830 par Robiquet dans les amandes amères (Prunus dulcis). |
Annexe 3
Caroténoïdes
Ce
groupe comprend les carotènes et les xantophylles. Ils colorent
en jaune, orange, exceptionnellement en rouge, la carotte, les abricots, le maïs,
la citrouille, le safran, les œufs, la crème de lait, les crustacés cuits
(rupture avec une protéine), les feuilles en automne, la tomate, etc…. Ils sont
masqués par la chlorophylle dans les feuilles vertes.
- Carotènes : On peut
citer l'α ou le β- carotène ou encore le lycopène.
|
|
|
|
α-Carotène |
β-Carotène |
|
|
|
|
Lycopène |
|
- Xantophylles : On peut
citer la zéaxanthine, la lutéine, l'astaxanthine ou la crocétine.
|
|
|
|
Zéaxanthine |
Lutéine |
|
|
|
|
Astaxanthine |
Crocétine |
Un des
flavonoïdes du safran : le kaempférol
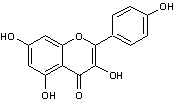
Annexe 4 La
couleur du safran
|
|
Les stigmates du safran produisent une couleur jaune, lumineuse.
Mais plus la quantité de safran est importante et plus la couleur devient
rouge. Le safran servait à teindre les vêtements des rois babyloniens
perses ou mèdes. Les bouddhistes portent traditionnellement des robes couleur
safran, mais qui sont le plus souvent teintes avec du curcuma, une épice
beaucoup moins chère que le safran. |
Annexe 5 Les
crocines
Il existe en fait plusieurs crocines qui
correspondent à des hétérosides ayant la même partie aglycone la crocétine mais
des parties glucidiques différentes.
-
Partie aglycone
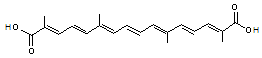 C'est la crocétine "toute trans" c'est l'isomère le plus
stable (voir remarque ci-après)
C'est la crocétine "toute trans" c'est l'isomère le plus
stable (voir remarque ci-après)
- Differentes parties glucidiques :
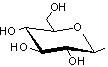
R1
et R2 pouvant
être :
|
A Glucosyle |
B Gentiobioside |
|
C 3-β-glucosyle |
D Néapolitanosyle |
-
L'ensemble des crocines correspond à :
·
Crocine 1 : R1= D ; R2 =
B
·
Crocine 2 : R1= C ; R2 =
B
·
Crocine 3 : R1= A ; R2 =
B
·
Crocine 4 : R1= B ; R2 =
B
·
Crocine 5 : R1= A ; R2 =
A
·
Crocine 6 : R1= H ; R2 =
A
Remarque :
La partie aglycone peut être la
crocétine "cis"
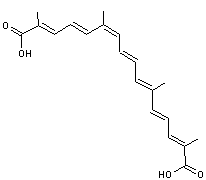
avec les mêmes substituants.
Annexe 6 Le safran
pur
Spécifications chimiques du
safran selon la norme ISO/TS 3632
|
Carastéristiques |
Catégorie I |
Catégorie II |
Catégorie III |
|
Humidité et teneur en matières
volatiles (fraction massique), %, max Safran en filament Safran en poudre |
12 10 |
12 10 |
12 10 |
|
Cendres totales (masse) sur
matière sèche, %, max. |
8 |
8 |
8 |
|
Cendres insolubles dans l'acide
(fraction massique), %, sur matière sèche, max. |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
|
Extrait soluble dans l'eau
froide, (fraction massique), %, sur
matière sèche, max. |
65 |
65 |
65 |
|
Saveur amère, E1% 1 cm
257 nm, sur matière sèche, min. |
70 |
55 |
40 |
|
Safranal, , E1% 1 cm 330 nm, sur matière sèche (A
cette longueur d'onde, l'absorbance du safranal est maximale). Min. Max. |
20 50 |
20 50 |
20 50 |
|
Pouvoir colorant, E1%
1 cm 440 nm, sur matière sèche, (A cette longueur d'onde, l'absorbance de la
crocine est maximale). Min. |
190 |
150 |
100 |