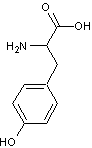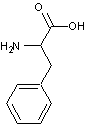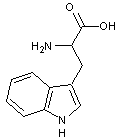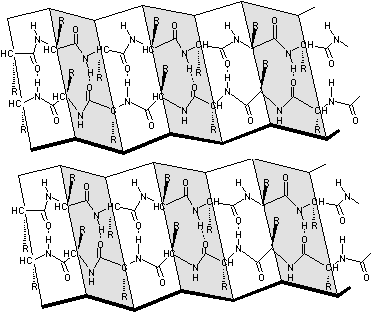LA SOIE
Gérard GOMEZ
Avec la collaboration
de Jacques BARON.
Plan de l'exposé
1) Soie –
Soie sauvage – Soie artificielle
2) La
soie
2-1) La fibroïne
2-2) La séricine et les autres constituants
2-3) La sériciculture – Le ver à
soie
2-3-1) La
sériciculture
2-3-2) Bombyx mori
2-5) Les traitements de la soie
2-6) Quelques dates
5-2) Production industrielle de
soie d'araignées
5-3) Applications
1) Soie – Soie
sauvage – Soie artificielle :
La soie est le produit filamenteux des
glandes séricigènes des araignées et des larves de divers insectes.
Le matériau qui a été le plus utilisé
pour fabriquer des textiles dits "en soie naturelle" correspond à la
sécrétion des chenilles du bombyx du
mûrier (Bombyx mori) lorsqu'elles
fabriquent leur cocon pour abriter leur nymphose.
Les soies dites sauvages ou tussah sont
obtenues à partir d'autres cocons que ceux de Bombyx mori ; ce sont généralement ceux de larves de papillons du
genre Antheraea vivant sur des
chênes, en Inde ou en Chine.
Ce que l'on a appelé la soie artificielle
c'est-à-dire la rayonne est obtenu par traitement d'un polymère naturel, la
cellulose.
2) La soie :
La soie brute (on dit
grège) est constituée d'environ 65% de fibroïne, un polypeptide relativement
simple dont la composition (nature des aminoacides qui la composent) varie
suivant la larve qui l'a produite (différente donc pour la soie et la soie
sauvage).
La fibroïne de la soie du
bombyx du mûrier est une protéine fibreuse constituée de 17 aminoacides
principaux ; elle est très riche en glycine (38%), alanine (25%), sérine (13%)
tyrosine (12%) mais elle contient aussi de la phénylalanine et du tryptophane :
|
Glycine (abréviation :
Gly)
|
Alanine (abréviation :
Ala)
|
|
Sérine (abréviation :
Ser)
|
Tyrosine (abréviation :
Tyr)
|
|
Phénylalanine
(abréviation Phe)
|
Tryptophane (abréviation
Trp)
|
La structure de la
fibroïne est séquencée c'est-à-dire que sa macromolécule est elle-même formée
d'éléments macromoléculaires qui diffèrent entre eux par leur constitution. On
y trouve de nombreuses séquences Gly-Ala-Gly :
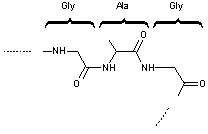
et de nombreuses séquences
Gly-Ser-Gly :
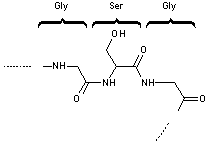
arrangées en feuillets
plissés antiparallèles dans lesquels les chaînes latérales de l'alanine (-CH3)
et de la sérine (-CH2OH), désignés par "R" dans la
représentation ci-dessous, se glissent dans des "creux" des feuillets
voisins. La périodicité de la fibroïne, c'est-à-dire la distance entre deux C=O
qui ont la même orientation est de 0,7nm ce qui
est compatible avec une telle structure.
|
|
|
|
La fibroïne est flexible
car l'empilement des feuillets n'est maintenu que par des interactions de Van
der Walls (liaisons de faible énergie) ; la soie est moyennement extensible car
lorsqu'on tire selon l'axe des chaînes constituant les feuillets, on tire sur
des liaisons covalentes (liaisons de forte énergie).
Ces zones
"microcristallines" (du fait de la très grande uniformité de
structure) correspondant à des aminoacides de faible masse molaire, donnent à
la soie sa ténacité (aptitude à résister à la déformation ou à la rupture sous
un effort continu), sa charge de rupture se situe entre 300 et 600 N/mm2 comme
l'acier doux, supérieure à celle de l'aluminium (100N/mm2) ; elles
alternent avec des zones amorphes constituées de macromolécules de masse
molaire plus élevée (formées avec tyrosine, phénylalanine, tryptophane)
réparties statistiquement, assurant à la fibroïne sa résilience (aptitude à
subir des efforts brusques ou des chocs sans rupture).
La masse molaire moyenne
de la fibroïne se situe entre 350 et 415 kiloDaltons.
2-2) La séricine et les
autres constituants :
Dans la soie grège,
directement issue du cocon, la fibroïne est entourée d'un matériau appelé
séricine que l'on enlève (décreusage) lorsqu'on souhaite utiliser la soie dans
l'industrie textile.
La séricine (entre 20 et
25% du filament de grège) est une protéine constituée par les mêmes aminoacides
que ceux de la fibroïne, en proportions différentes. Cette protéine globulaire
est de structure amorphe analogue à celle de la gélatine.
Outre la fibroïne et la
séricine on trouve de l'eau (environ 12%) et des traces de matières grasses, de
matières cireuses, de matières colorantes et de matières minérales.
2-3) La sériciculture –
Le ver à soie :
2-3-1) La
sériciculture :
C'est une activité qui
englobe toutes les opérations se rapportant à l'élevage du ver à soie jusqu'à
la production du cocon.
Elle est pratiquée depuis
très longtemps en Chine et en Inde et s'est répandue dans l'Empire romain au VIème
siècle et en France à la fin du XVIIIème siècle ; les bâtiments
servant à cet élevage s'appellent des magnaneries.
Les opérations sont
nombreuses et délicates et nécessitent des conditions assez drastiques de
température, d'hygrométrie mais aussi d'hygiène pour éviter les maladies.
2-3-2) Bombyx mori :
Le bombyx du mûrier est un
papillon (lépidoptère) domestique nocturne ; il est inconnu à l'état sauvage.
La femelle plus grande que
le mâle ne vole pas. Le mâle peut, grâce à des antennes très développées,
déceler une phéromone émise par la femelle, le bombykol (voir tableau 1 en annexe) et venir s'accoupler avec elle.
Cinq cents œufs environ
(encore appelés graines) sont pondus trois jours après et donnent naissance au
bout d'environ quinze jours à des chenilles qui après quatre mues atteindront
l'état adulte.
C'est la chenille qui
élabore la matière soyeuse (au début c'est une substance gélatineuse) dans deux
glandes séricigènes ; ces deux glandes débouchent chacune sur un tube
capillaire ; ces deux tubes se réunissent pour former un seul conduit appelé
filière d'où sort un fil unique devenant consistant (soie grège) que la chenille
enroule autour d'elle pour former le cocon. C'est dans ce cocon que le ver à
soie se transforme en chrysalide ; le papillon qui en résulte perce le cocon en
secrétant une salive alcaline qui va dissoudre la soie et sort de son
enveloppe. Le cycle peut recommencer.
La chenille se nourrit
exclusivement de feuilles de mûrier, essentiellement le mûrier blanc (Morus alba) un arbre de la famille des
moracées, originaire de Chine et pouvant atteindre 18m de hauteur mais le plus
souvent taillé à une hauteur bien inférieure pour faciliter le ramassage des
feuilles ; les quantités ingurgitées par les chenilles dépendent de leur stade
de développement et deviennent considérables au stade adulte.
2-4)
Les traitements du cocon :
Un cocon correspond à un
fil de soie grège de longueur variant entre 800m et 1500m. Pour éviter que ce
fil ne soit coupé au moment où le papillon perce le cocon pour sortir, on tue
la chrysalide dans le cocon en soumettant celui-ci à de l'air chaud (70°C) ou
en le plaçant dans une étuve.
- La filature :
On plonge le cocon dans de
l'eau bouillante et on le soumet à un brossage vigoureux à l'aide de brosses
mécaniques rotatives spéciales, ce qui permet d'enlever les petits fils
discontinus de l'extérieur du cocon (blazes) et de dégager l'extrémité libre du
fil que l'on dévide ensuite.
Selon la grosseur du fil
que l'on souhaite on dévide simultanément un certain nombre de cocons placés
dans de l'eau à 90°C ; on réunit les fils et on les fait passer dans un orifice
unique appelé filière. Comme on ne peut pas mesurer le diamètre des fibres
naturelles compressibles et pas très lisses on utilise la masse d'une certaine
longueur de fil ; plus elle est importante, plus le fil est gros. Une des
unités anciennement utilisée est le denier qui correspond en grammes à la masse
de 9000m de fil (un fil d'un denier a une masse de 1g pour 9000m de longueur ;
on utilise aujourd'hui le tex qui correspond à 1g pour 1000m de longueur ; 1
tex équivaut donc à 9 deniers). Par comparaison avec des fibres artificielles dont
on peut mesurer le diamètre et en considérant que les masses volumiques ne sont
pas très différentes, on peut évaluer les diamètres des fils de soie à partir
du denier. On considère qu'un denier correspond à un diamètre de 10µm. Des fils
de 16 deniers soit 40 µm (il n'y a pas proportionnalité car la masse augmente
comme le carré du diamètre) par exemple sont parmi les plus fins dont on peut
raisonnablement faire usage.
2-5) Les traitements de la soie
:
- La croisure :
C'est une opération qui
consiste à croiser le fil précédemment obtenu sur lui-même ou sur d'autres
fils, ce qui le polit et l'arrondit ; on le dispose enfin en écheveaux sur un
dévidoir appelé guindre.
- Le moulinage :
On tord le fil de soie
grège pour en augmenter la résistance ; cette opération permet aussi d'évacuer
certaines impuretés qui adhèrent encore au fil.
- Le décreusage :
A ce stade on souhaite
débarrasser le fil de soie de sa gaine de séricine (grès) pour lui donner
souplesse et brillance. On le place pour cela dans de l'eau savonneuse chaude.
Si le décreusage est total
on obtient de la soie souple ; s'il n'est que partiel on dit que la soie est
cuite, ou mi-cuite s'il est encore plus imparfait.
Pour compenser la perte de
poids de la soie souple due à la perte de séricine et pour qu'elle couvre mieux
au tissage, on la fait gonfler en précipitant un silicophosphate d'étain sur la
fibroïne.
Les déchets résultant de
toutes les opérations précédemment décrites, sont récupérés et travaillés ; on
en fait un fil appelé schappe qui est utilisé dans certaines opérations de
tissage.
- La
teinture :
La soie est une fibre
protéinique animale mais s'agissant de la mettre en contact avec des colorants,
il faut tenir compte des particularités dues à sa constitution.
Le grès (gaine de
séricine) est imperméable à la teinture donc il faut décreuser.
On peut réaliser la
teinture ou l'impression d'un tissu de soie. Si on veut teindre les fils de
soie pour obtenir des effets après tissage, on fait des écheveaux.
Les éléments de la soie
susceptibles de permettre la fixation des colorants sont les groupes
peptidiques –CO-NH- ainsi que en proportions bien plus faibles, les groupes
terminaux –NH2 (ou NH3+) et –COOH (ou –COO-).
La soie peut-être traitée
:
- par des colorants substantifs : les liaisons hydrogène peuvent se faire à
partir de

- par des colorants acides (dits anioniques) ; les anions –COO-,
SO3-, -O- du colorant se fixent sur

NB
: Les colorants basiques (dits cationiques) ne donnent pas de résultats
acceptables, ce qui peut sembler prévisible, les groupes –COO- de la
soie étant en proportion relativement faible.
- Par mordançage : des liaisons issues de N et O pouvant
s'établir avec le cation du mordant :
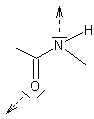
- Par des colorants réactifs mais on ne maîtrise pas encore toujours la
couleur obtenue en utilisant ces colorants récents et complexes.
2-6) Quelques dates :
L'origine du travail de la
soie est l'Orient.
La Chine qui le pratiquait
déjà 1700 ans avant J.C. en a gardé très longtemps le monopole.
Le transport et le
commerce de la soie avant l'ère chrétienne déjà, se faisait grâce à des
caravanes qui traversaient l'Asie et reliaient la Méditerranée à la Chine à
travers l'Afghanistan, le Turkestan, … C'est ce qu'on a appelé la route de la
soie.
Il a fallu attendre le VIème
siècle pour qu'il se développe au Moyen-Orient et en Grèce et le XIIème
siècle pour le trouver en Italie via la Sicile, puis en Espagne.
Louis XI crée en 1480 la
première manufacture à Tours. La fabrique de Lyon voit le jour en 1536 grâce à
François Ier. A la fin du XVIème siècle Henri IV
encourage l'élevage du ver à soie et fait planter (grâce aux travaux d'Olivier
de Serres) 400 000 mûriers notamment en Cévennes et en Ardèche.
Au XVIIIème
siècle les soieries lyonnaises acquièrent une réputation universelle et c'est
au XIXème siècle qu'est inventé le métier Jacquard.
Dans la seconde moitié du
XIXème siècle commence le déclin de la soierie lyonnaise sous l'effet de
l'industrialisation, de la concurrence étrangère mais aussi de l'apparition de
la soie synthétique (Rayonne – Chardonnet 1890).
C'est de Chine, juste
retour des choses, que vient de nos jours, la plus grosse production de soie
grège et de soie tissée.
3) La
soie sauvage :
Bombyx mori ne se nourrit que de feuilles de mûrier. C'est ce qui limite en pratique,
la rentabilité de l'industrie de la soie.
La Chine et l'Inde ont
cherché à contourner cette difficulté en utilisant des vers se nourrissant de
feuilles d'essences forestières très variées ; ces vers appartiennent à
certaines espèces du genre Antheraea ;
dans les zones tropicales c'est la soie de A.mylitta
qui est exploitée commercialement et dans les zones tempérées il s'agit de
la soie d'un hybride interspécifique issu du croisement de A. roylei et de A.pernyi.
Cette soie sauvage porte
le nom de tasar en Inde et de tussah ou tussor à l'étranger. Il existe
plusieurs variétés de soie sauvage ; celle qui est la plus irrégulière avec une
texture marquée porte le nom de "shantung".
Depuis le 8 juillet 1934
la dénomination soie artificielle correspondant à un matériau obtenu à partir
de la cellulose, susceptible d'être filé et ressemblant à de la soie est
interdite ; les fabricants ont unanimement choisi l'appellation rayonne.
La cellulose est une macromolécule
linéaire et non–ramifiée, formée d'environ 500 à 5000 unités monomères de
glucose reliées les unes aux autres par des liaisons β–glycosidiques.
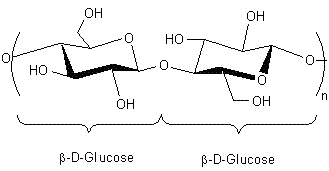
La cellulose est la substance
de soutien (parois) des cellules des plantes (par exemple dans le cas du bois).
Lorsqu'on traite la
cellulose par de la soude concentrée, on obtient un
"alcali-cellulose" qui réagissant avec du sulfure de carbone CS2,
conduit au xanthate de cellulose.
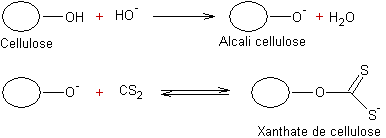
Le xanthate de
cellulose se dissout dans la soude en donnant un liquide sirupeux, la viscose,
qui se coagule au contact des acides en donnant une substance transparente et
brillante qui peut donner des fils
appelés rayonne.
Les tissus de rayonne
ressemblent à ceux en soie.
C'est le chimiste Chardonnet qui mit au point
en 1890 à Besançon, le procédé de fabrication de la rayonne en reprenant l'idée
du chimiste Suisse Audemars.
La soie des araignées est
produite, comme chez le ver à soie, par des glandes spécialisées, les glandes
séricigènes ; elles conduisent à différents types de soie (on en compte 8) pour
diverses fonctions (construction de toiles, enveloppement des proies,
reproduction, etc.).
La soie est principalement
constituée de fibroïne, une protéine dont nous avons vu précédemment la
composition et la structure, et de spidroïne, des protéines également
riches en glycine et en alanine
L'agencement des protéines
de spidroïne schématisées ci-dessous donnent à la soie des propriétés
mécaniques uniques.
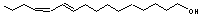
Les feuillets b des spidroïnes peuvent former des domaines cristallins qui apportent
force et rigidité alors que les régions amorphes entre ces domaines permettent
élasticité et extensibilité. C'est cette combinaison des domaines ordonnés et
désordonnés qui donne à la soie d'araignée ses propriétés remarquables.
La soie d'araignée est
souvent comparée à l'acier en termes de résistance à la traction, sa charge de
rupture se situant entre 1000 et 2000 N/mm2 (soit environ 3 fois
celle de la soie du ver à soie), mais elle est beaucoup plus légère et
extensible, capable de s'étirer plusieurs fois sa longueur sans se rompre.
5-2) Production industrielle de soie
d'araignées
La production industrielle
de fils de soie d'araignée a fait l'objet de nombreuses recherches en raison de
leurs propriétés remarquables : résistance, élasticité et légèreté. Voici un
aperçu des principales approches et recherches dans ce domaine :
Les araignées sont
difficiles à élever en grand nombre à cause de leur comportement territorial et
cannibale.
Pour contourner ce problème, les scientifiques ont inséré des gènes de soie
d'araignée dans d'autres organismes plus faciles à cultiver.
- Des bactéries : Les
bactéries comme E. coli ont été modifiées pour produire des protéines de soie,
mais les rendements sont souvent faibles.
- Des levures : Certaines
recherches ont utilisé des levures pour produire des protéines de soie, offrant
un meilleur rendement que les bactéries.
- Des plantes : On a inséré
des gènes dans des plantes comme le tabac et les pommes de terre pour produire
de la soie d'araignée dans leurs feuilles ou tubercules.
- Des vers à soie : idem pour
les vers à soie, déjà utilisés pour produire de la soie traditionnelle, avec
des résultats prometteurs.
- Des mammifères : Des chèvres
transgéniques ont été créées pour produire de la soie d'araignée dans leur
lait. Ces protéines sont ensuite extraites et filées en fibres.
Des essais de synthèse chimique ont été tentés, mais elles restent complexes et
coûteuses.
En outre, des processus biomimétiques pour reproduire les méthodes de filage
ont été développés afin d'obtenir les mêmes propriétés mécaniques.
Les chercheurs travaillent aussi sur l'optimisation des conditions de culture
des organismes génétiquement modifiés (température, pH, nutriments, etc.) pour
maximiser la production de protéines de soie.
5-3) Applications
La soie d'araignée produite
artificiellement est étudiée pour des applications variées : médecine (sutures,
implants), textiles haute performance, matériaux composites, et même pour des
usages dans l'industrie aérospatiale.
|
ou Hexadécadièn-10(E)-12(Z)-1-ol C16H30O Masse molaire : 238,4088 g.mol-1 N° CAS 765-17-3 |
Molécule de bombykol
Bombyx mori |
Cette molécule est la
première phéromone à avoir été isolée, dans les années 1960, du Bombyx du
murier (Bombyx mori) un ver à soie qui lui a donné son nom. Il a fallu 500 000
femelles de ver à soie pour extraire 6 ng de composé (6.10-9 gramme). Rappelons qu’ une
phéromone est une substance qui, après avoir été secrétée à dose infime par
un animal, est perçue par un individu de la même espèce chez lequel elle
provoque une réaction comportementale. Le bombyx du murier détecte la
phéromone émise par sa femelle (le bombykol) dès qu'il y a plus de 192
molécules de bombykol par mL d'air ; Le mâle en quête de partenaire vole en
zig-zag en remontant les courants d'air jusqu'à ce qu'il atteigne les
femelles émettrices. |